« La poursuite de la connaissance est le bien suprême »
Socrate, philosophe grec, Ve siècle av. J-C
La recherche de l’unité du savoir, idéal philosophique, a été à la base de l’éducation jusqu’à ce que le concept de discipline apparaisse.
Ainsi, jusqu’au 18ᵉ siècle, les savants comme Newton et Galilée cherchent à comprendre le monde dans sa globalité. Ils sont à la fois mathématiciens, physiciens, philosophes, alchimistes, astronomes ou encore théologiens.
La classification des savoirs en catégories et l’apparition de disciplines émergent progressivement vers la fin du 18ᵉ siècle avec la création des encyclopédies puis la structuration du système scolaire.
Les disciplines scientifiques apparaissent au 19ᵉ siècle. Elles reposent sur la professionnalisation de la recherche et la spécialisation croissante des chercheurs. On assiste en conséquence à un éclatement des sciences dans l’enseignement : mathématique, physique, chimie, géologie, biologie, technologie, ingénurie, etc. Plus les élèves progressent dans le cursus scolaire, plus cette fragmentation s’accentue, chaque discipline se divisant en sous-catégories enseignées séparément, sans mise en lien explicite.
Comme le montre Yves Lenoir dans Les Cahiers de la recherche en éducation (1995)[1], cette tendance croissante au cloisonnement dans l’éducation a été vivement critiquée dès le début du 20ᵉ siècle par de nombreux pédagogues.
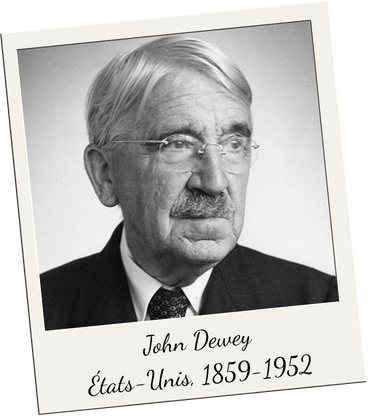
[2], J. (1986, September). Experience and education. In The educational forum (Vol. 50, No. 3, pp. 241-252). Taylor & Francis Group. » class= »js–wpm-format-cite »>Dewey[2] rejette l’idée que l’on puisse enseigner des connaissances pures sans les relier à des situations concrètes. Il s’oppose ainsi à l’idée de découper l’apprentissage en matières isolées et défend une approche interdisciplinaire.
Selon Vygotsky[3], les élèves construisent de nouveaux savoirs sur la base des connaissances qu’ils possèdent déjà. Il soutient de ce fait que la séparation des disciplines limite leur capacité à établir des connexions et à construire une connaissance globale comportant des éléments de l’ensemble des disciplines.

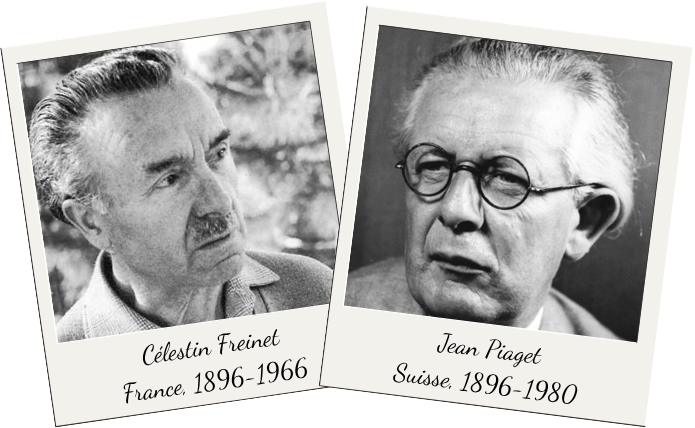
Freinet et Piaget[4] insistent sur l’importance de la pédagogie active en proposant de placer les élèves face à des situations-problèmes concrètes dans lesquelles ils sont amenés une fois de plus à croiser leurs savoirs pour cheminer vers la solution.
Ces recherches conduisent, dans plusieurs pays, à l’émergence de politiques éducatives visant à réintroduire des approches globales et interdisciplinaires.
« On ne devrait jamais instruire qui que ce soit de manière à perfectionner un type de connaissance à l’exclusion des autres »
Comenius, pédagogue morave, 17ᵉ siècle
C’est de cette volonté qu’apparaissent les STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) aux États-Unis dans les années 1990, puis les STEAM dix ans plus tard, avec l’ajout des arts[5].
- [1] Lenoir, Y. (1995). L’interdisciplinarité: aperçu historique de la genèse d’un concept. Cahiers de la recherche en éducation, 2(2), 227-265.
- [2] Dewey, J. (1986, September). Experience and education. In The educational forum (Vol. 50, No. 3, pp. 241-252). Taylor & Francis Group.
- [3]
- [4] Driscoll, M. P., & Burner, K. J. (2005). Psychology of learning for instruction.
- [5] Yakman, G. (2008, February). STEAM education: An overview of creating a model of integrative education.
